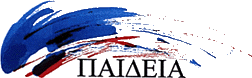1. Théorie et pratique
Les droits de l’homme, en cette fin de siècle, se trouvent dans
une situation paradoxale: d’un côté, sont proclamés dans divers textes légaux un
nombre croissant de droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, qui
constituent, dans l’histoire du droit, l’affirmation la plus achevée de la
croyance de l’homme en sa propre dignité; d’un autre côté, toutefois, ces
mêmes droits deviennent des idéaux utopiques dans la mesure où ils sont
systématiquement enfreints par des groupes sociaux et des gouvernements. Les
gouvernements autoritaires contribuent eux-mêmes à l’idéalisation de ces droits,
car ils tiennent à affirmer leur allégeance à ces droits, mais prennent, toutefois, la
précaution de défendre des interprétations particulières en ce qui concerne
l’étendue, le système de protection et le propre fondement des droits de
l’homme.
Ce conflit entre valeurs universelles, textes légaux et pratiques
politico-juridiques a fini par faire considérer que les droits de l’homme ne sont
qu'une promesse utopique, vouée à la disparition dans le monde éthéré des idéaux non
réalisés. Le débat académique sur ce thème n’a fait apparaître, jusqu’à
récemment, qu’une forte incrédulité quant aux possibités de constituer un ordre
politique et juridique au coeur duquel se trouveraient les droits de l’homme et qui
serait en mesure d'empêcher les violations des droits fondamentaux de la personne. Cette
incrédulité intélectuelle ne s’est pas étendu, toutefois, au sentiment de
révolte qui s’empare de l’homme ordinaire, car celui-ci dans beaucoup de pays
exprime fortement sa répulsion envers les politiques publiques et les situations sociales
qui violent ces droits. La question des droits de l’homme a fini, ainsi, par
s’imposer au juriste et au législateur en raison de la prise de conscience de la
société. La volumineuse législation internationale et nationale sur ce thème a élargi
le domaine des droits de l’homme qui désormais ne sont plus exclusivement une forme
de droit personnel, mais qui expriment maintenant des droits sociaux, économiques,
culturels et politiques qui s’affirment dans le processus de libéralisation et de
démocratisation de la majorité des sociétés et des états contemporains.
2. Une expression à la recherche d’un concept
L’emploi de l’expression "droits de l’homme"
reflète autant cette globalité que l’imprécision conceptuelle qui en résulte,
dans son utilisation. Elle peut signifier des situations sociales, politiques et
culturelles différentiées: elle exprime souvent des manifestations émotives devant la
violence et à l’injustice; en fait, la multiplicité de ses usages indique surtout
le manque de fondements communs qui pourraient contribuer à l’universalisation de sa
signification. Un grand nombre d’auteurs prend l’expression "droits de
l’homme" comme un synonyme de ‘droits naturels", les premiers étant
la version moderne des derniers (Finnis, 1989: 198; Rommen , 1955: 624); d’autres
soutiennent que la Déclaration des droits de l’homme s'ímpose sans doute en raison
de la volonté du constituant, mais que celui-ci n’exprime qu’une conception
formelle, laissant de cette façon aux interprètes la tache de donner un contenu à ces
droits ( Troper, 1994:328); d’autres encore, considèrent l’expression comme une
définition de l’ensemble de droits qui se trouveraient ainsi définis dans les
textes internationaux et légaux, ce qui veut pas signifier que de "nouveaux droits
ne puissent être consacrés dans l’avenir" ( Mello: 1997:5 ).
Dans la pensée sociale contemporaine, l’oeuvre de John Rawls
(1997: 74-75) se détache par la définition des droits fondamentaux de l’homme comme
"norme minimale"des institutions politiques possédant de ce fait un statut
spécial, car une norme minimale de conduite doit s’appliquer à tous les États qui
intègrent une société politique juste des peuples. Les droits de l’homme, pour
Rawls, diffèrent des garanties constitutionnelles ou des droits de citoyenneté
démocratique, et exercent trois rôles majeurs: en premier lieu, l’observance des
droits de l’homme constitue la condition nécessaire pour la légitimation d’un
régime politique et pour que soit accepté son ordre juridique; le respect des droits de
l’homme, dans le Droit interne des nations, représente pour Rawls, la condition
suffisante pour que l’intervention dans les affaires internes d’autres nations
soit exclue, à l’aide, par exemple, de sanctions économiques ou moyennant
l’usage de la force militaire; finalement, Rawls ( 1977:79) soutient que les droits
de l’homme constituent la dernière limite au pluralisme entre les peuples. Les
droits humains, pour Rawls, représentent des normes juridiques et politiques qui se
réfèrent au monde des relations entre les nations, et expriment des engagements
nationaux envers des valeurs destinées a établir un ordre international politiquement
juste. Les droits de l'homme ont leur importance dans le plan des relations entre les
États lesquels, pour être légitimés dans la communauté internationale, doivent fonder
leurs droits internes respectifs, sur le respect de la norme minimale internationale.
On constate, donc, que l’ombre des droits naturels en tant que
modèle justificateur du droit positif surplombe le débat sur les fondements des droits
humains, Le problème auquel se sont vu confrontés quelques juristes a été, justement,
celui de la nécessité de structurer logiquement, du point de vue juridique, l’idée
des droits humains avec celle de l’ordre juridique positif. La voie trouvée par
Georg Jellinek (1908: 90-91) a consisté a récupérer la théorie des droits subjectifs,
moyennant l’introduction de la nouvelle catégorie de droits publics subjectifs.
Jellinek prétendait, ainsi, rompre le lien qui unissait les droits naturels aux droits de
l'homme. Le juriste allemand soutenait que la déclaration des droits de l’homme de
la Révolution Française de 1789 avait forcé une élaboration théorique de la
catégorie des droits publics subjectifs jusque là ignorés et que c'est par son
entremise, que l'on peut situer les droits humains dans le système juridique. Ces droits,
proclamés face à l’Etat, ont transformé des normes, jusque là considérées comme
de droit naturel, et donc sans coercition, en normes de droit positif. La catégorie
créée par Jellinek ne s’est pas refléchie, toutefois dans la pratique juridique et
dans la politique des gouvernements et des sociétés, en raison des caractéristiques
particulières propres aux droits de l’homme à la fin du XIXème siècle. Le texte
classique de Hannah Arendt qui porte le titre "les perplexités des droits
humains" ( 1962: 290 et suivantes), démontre comment les droits de l’homme se
sont identifiés à l’identité nationale. Et qu'ainsi, ces États nationaux, en
raison des circonstances historiques et politiques des sociétés nationales en phase
d’affirmation, sont incapables d’étendre aux non-nationaux les droits publics
subjectifs assurés aux nationaux. Il est donc évident que le nationalisme a constitué
l’obstacle le plus important à la garantie de droits qui se caractérisaient par une
universalité nécessaire.
En vertu de cette connotation nationale attribuée aux droits de
l’homme, considérés comme des garanties fondamentales assurés par l’État
National de Droit, le thème des fondements de ces droits a été progressivement voué à
l’oubli. Pendant le XXème siècle, on constate la prolifération de déclarations
internationales et des législations nationales voulant garantir les droits de
l’homme, et également l’échec de la part des différents systèmes juridiques
en ce qui concerne les garanties réelles d'observation des dispositions légales. Le
conflit entre valeurs et pratiques politique et juridique a déclenché, dans le domaine
de la théorie juridique, un processus de réductionnisme épistémologique du thème
"droits de l’homme", qui a fini par se restreindre à sa dimension
positive, telle qu’elle se trouve dans le domaine de la législation. La réflexion
sur les fondements des droits de l’homme est devenue significative et s’est
inscrite dans le plan d’une réflexion métajuridique au moment où les violations de
ces droits, dans la pratique quotidienne, finirent par entraîner un niveau élevé de
relativisme dans leur interprétation et une insécurité croissante dans les relations
entre les États et les groupes sociaux dans le sein de la propre société civile.
C’est dans ce contexte, qu'il est devenu impératif de distinguer
dans l’analyse des droits de l’homme, deux niveaux épistémologiques
corrélationnés: au premier niveau on examine la question de leurs
fondements—question, qui comme on l’a vu à été reléguée au deuxième plan
dans la pensée juridique moderne; au second niveau, sont examinés les mécanismes pour
la garantie et la pratique des droits de l’homme, thème qui occupe, de façon
prioritaire, l’attention des auteurs contemporains. Ces auteurs partent du principe
que l’analyse de la fondamentation des droits de l’homme est une question
métajuridique, et en tant que telle, non significative pour la pratique juridique. Un
nombre croissant de philosophes et de juristes indiquent la nécessité de la
récupération de la thématique de la fondamentation des droits humains, considérant,
précisément l’expérience historique qui démontre la fragilité de cette
catégorie de droits face à des gouvernements autoritaires.
Les aspects juridiques et politiques de la question, ont joué, ainsi,
un rôle prédominant dans la pensée juridique du XXème siècle. Bobbio (1922; 25-26),
par exemple, considère que le problème des fondements des droits de l’homme
(l’aspect philosophique de la question) se résoud par l’accord des signataires
des différentes déclarations des droits de l’homme: "en effet, le problème
que nous avons devant nous n’est pas philosophique, mais juridique, et dans un sens
plus large, politique. Il ne s’agit plus de savoir quels sont ces droits, quelle est
leur nature et leurs fondements, s’il s’agit de droits naturels ou historiques,
absolus ou relatifs, mais plutôt de connaître la façon la plus sure de les sauvegarder,
pour empêcher qu’en dépit des déclarations solennelles ceux-ci soient
continuellement violés... En effet, on peut dire que le problème des fondements des
droits de l’homme a trouvé sa solution actuelle dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10
décembre 1948."
Ces convictions partagées par les différents pays signataires de la
Déclaration des Nations-Unies de 1948 n’ont cependant pas eu de conséquences
pratiques significatives, car la violation répétée des droits de l’homme par des
pays signataires de cette Déclaration, et des documents internationaux ultérieurs, et
naturellement des propres textes constitutionaux nationaux consacrant les valeurs de
l’être humain, met en évidence le besoin permanent de défendre les droits de
l’homme. Bobbio, comme on l’a déjà vu plus haut, argumente que le problème
essentiel de ces droits réside dans la détermination des moyens à être mis en oeuvre
pour que ceux-ci puissent être assurés. Cette affirmative—très vraie d’un
côté, puisque les droits dont l’observance n’est pas assurée deviennent un flatus
vocis vide de contenu et de sens social—n’épuise pas le problème. Ceci
parce que ce qui est mis en question dans la violation des droits de l’homme est la
nécessité même d’une catégorie de droits universels qui traversent l’ordre
juridique national et qui établissent des limites à l’exercice du pouvoir.
La "reconstruction des droits de l’homme" (Lafer,
1991)—considérés comme un ensemble de droits exprimant des valeurs propres à
l’être humain et dont la gestation est continue—exige une attention toute
spéciale en ce qui concerne ses fondements, principalement si l’on tient en compte
sa dimension juridique et politique. La question des fondements des droits de l’homme
trouve sa réponse dans l’investigation, développée par quelques auteurs
contemporains, qui a pour but l’établissement d’un palier juridique permettant
une conceptualisation englobante de ce type de droits. Cette méthodologie se justifie
aussi bien pour alimenter l’argumentation en faveur des droits de l’homme,
constamment menacés et violés par des régimes autoritaires, que pour limiter et
définir quels sont et quels ne sont pas les droits de l’homme (Fernandez, 1991).
L’enjeu de la réflexion sur les fondements des droits de l’homme réside, à la
limite, dans la recherche d’une fondamentation rationnelle de ces droits, donc
universelle, et qui puisse également justifier ou légitimer les propres principes
généraux du droit (Delmas-Marty, 1994: 172 et suivantes).
3. Le fondement critique des droits de l’homme
La nécessité d’une théorie fondationnelle des droits de
l’homme prend ses racines dans la pensée illuministe et sa formulation classique
apparaît dans le texte bien connu de Kant "les peuples de la terre participent à
des degrés divers d’une communauté universelle qui s’est développée à tel
point, que la violation du droit, commis en un endroit du monde, se répercute sur tous
les autres. L’idée d’un droit cosmopolite n’est donc pas fantastique ou
exagérée; il s’agit d’un complément nécessaire au code non-écrit du Droit
politique et international, en le transformant en un droit universel de l’humanité.
Ce n’est que sous ces conditions que nous pourrons nous féliciter d’avancer
continuellement en direction d’une paix perpétuelle."(1970: 107-108). Dans sa
"Doctrine du Droit" ( § 62), Kant soutient que cette communauté pacifique
n’est pas un "principe philanthropique (éthique), mais un "principe
juridique" qui se matérialise dans le droit dit cosmopolite. Ce type de droit
tend, selon Kant, à permettre une union possible de tous les peuples "en vue des
certaines lois universelles possibles du commerce". Kant, toutefois, a établi un
rapport entre le ius cosmopoliticum et le développement du commerce, ce qui
reflète, d’ailleurs, l’idée commune à l’époque, que le commerce serait
le facteur décisif pour permettre l’humanisation des relations entre les peuples.
Ce mythe sur les effets bénéfiques de l’amélioration des
relations entre les nations, en raison du commerce, est démenti par l’histoire des
deux dernier siècles. Le stade actuel du processus d’internationalisation de
l’économie, a bien démontré comment certains effets pervers de ce que l’on
appelle la mondialisation, font ignorer les droits fondamentaux de l’être humain. À
l’opposé de ce que soutenaient les idéologues du libéralisme classique,
l’internationalisation de l’économie a fait en effet croître la corruption
politique, le trafic des organes entre pays riches et pauvres, l’exploitation du
travail de l’enfant, l’esclavage blanc, le crime organisé, etc. Les résultats
des nouveaux types de relations économiques et sociales font apparaître un tableau de
distorsions et d’atteintes à la dignité de l’être humain qui ne pourra être
renversé que par un droit également global, cosmopolite et qui affirme et garantisse les
valeurs constitutives des dignités humaines ( Delmas-Marty, 1997).
L’histoire nous montre bien que les droits de l’homme ne sont
pas la conséquence du progrès des relations commerciales entre les peuples, mais plutôt
de la constatation de l’existence de valeurs communes aux diverses sociétés et
groupes d’une même société, qui se comportent comme "une dimension du droit
susceptible de figurer un universel " (Renaut - Sossoe, 1986: 32). Il s’agit,
donc, de relire la tradition kantienne, dans le contexte de laquelle les lois morales sont
les fruits da la raison de l’homme et sont, donc, universelles, ne dépendant pas,
ainsi, de la volonté circonstantielle du législateur. Cette relecture se fait en
identifiant des arguments rationnels permettant la fondamentation des droits humains en
principes universels.
Cette fondamentation critique ou morale (Tugendhat, 1997: 362 et
suivantes) pourra être construite à partir de la constatation que les droits de
l’homme renvoient aux exigences indispensables à la vie d’un être humain. La
sauvegarde et le maintien de la dignité humaine constitue le noyau de base des droits de
l’homme, car ce n’est que par leur intermédiaire que seront assurées les
multiples dimensions de la vie humaine, dimensions qui assurent toutes la réalisation
intégrale de l’être humain. La perspective critique part de l’hypothèse selon
laquelle ces diverses dimensions font que les droits qui en découlent ne se
matérialisent que dans le cadre de la société. La conception individualiste de
l’être humain cède la place, de cette façon, à la conception morale de
l’homme en tant qu’être social, et qui en tant que tel possède des droits qui
doivent être garantis par la société.
Le problème réside donc, dans la possibilité de
l’établissement d’un pont entre les valeurs morales et l’ordre juridique,
en refusant d’emblée une solution moraliste au problème, c’est-à-dire la
transformation du Droit en un instrument d’options morales des individus.
L’investigation dans ce domaine a conduit à l’introduction, dans l’aire de
la philosophie du droit, de la catégorie de l’impératif catégorique juridique
(Höffe, 1993: 91 et suivantes). Höffe soutient que l’impératif juridique,
quoiqu'il ne soit pas trouvé de façon explicite dans l’oeuvre de Kant, est
cependant suggéré par la philosophie pratique du penseur allemand. Cette nouvelle
catégorie d’impératif surgit, selon Höffe, dans la pensée kantienne sous trois
formes: en tant que concept universel du Droit (Kant, Doctrine du Droit, §B); en
tant que principe universel du Droit (Kant op. Cit. § C et conclusion de la II Partie);
et en tant également que loi juridique universelle (op. Cit. § C).
L’impératif juridique catégorique pourra servir à discerner les
principes moraux pouvant dépasser la tautologie contenue dans l’affirmative que les
droits de l’homme sont les droits de l’être humain. Pour cela, il devient
nécessaire de déterminer comment l’impératif juridique catégorique s’exprime
par des principes moraux qui sont impératifs et d’où dérivent les droits de
l’homme. La particularité principale des droits de l’homme est que ceux-ci se
réfèrent à des biens dont l’importance est essentielle pour l’être humain.
La définition des droits de l’homme se restreint, donc, lorsque l'on retire de son
cadre les droits moraux qui ne se réfèrent pas spécifiquement à la réalisation de
l’être humain. Les principes qui sont à la base des droits de l’homme, sont à
leur tour, dits catégoriques, car ils ne conditionnent pas la titularité des tels droits
aux conditions particulières des être humains, comme la nationalité, la richesse, la
religion, le genre etc... (Nino, 1989: 45).
Ces principes, qui formalisent l’impératif catégorique, se
combinent dans l’espace d’une société démocratique, et donc ordonnatrice de
relations intersubjectives d’êtres dotés de raison et libres, et servent de
fondements aux droits humains. Nino propose trois principes fondateurs: le principe de
l’inviolabilité de la personne, qui défend d’imposer des sacrifices à une
personne pour la seule raison que son sacrifice pourrait bénéficier d’autres
individus; le principe de l’autonomie de la personne, où est consacrée
l’impérativité d’assurer une valeur intrinsèque au idéaux d’excellence
de la personne humaine; le principe de la dignité de la personne, au moyen duquel
l’accès au droit est consacré, indépendamment de circonstances comme la race, la
religion, le sexe, le groupe social ou l’affiliation politique.
Les droits de l’homme constitueraient ainsi la positivation des
principes fondateurs qui, par leur nature morale, assurent le caractère
d’universalité de cette catégorie de droits. Dans ce sens, on peut dire, avec
Habermas, que la pensée kantienne représente "une institution directrice"
(1966: 80) dans le projet d’établir les fondements des droits de l’homme dans
notre époque contemporaine.

|